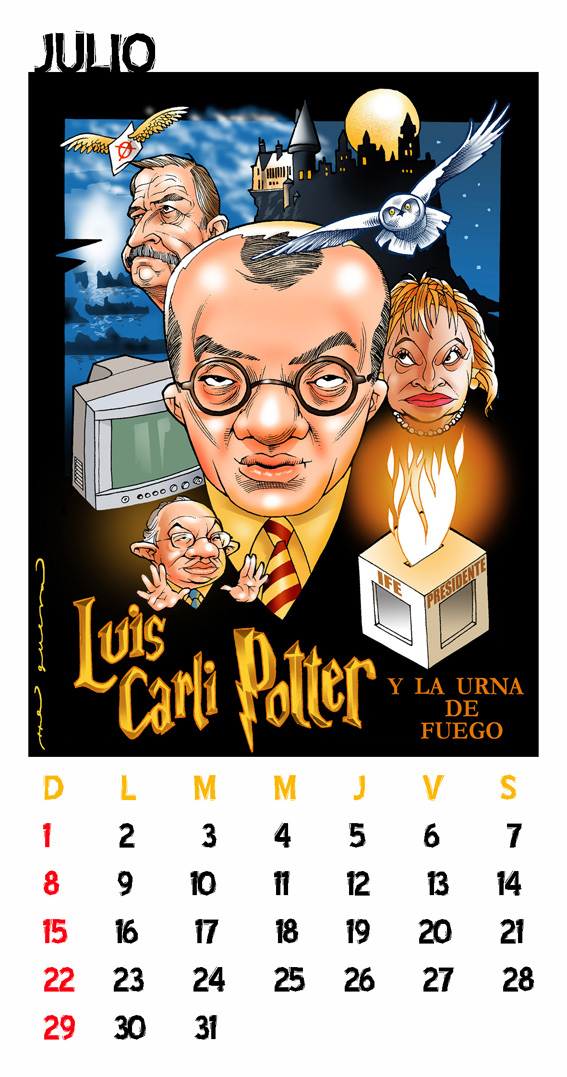Des présomptions de fraude sur l’élection présidentielle du 2 juillet 2006... Six mois de manifestations massives... Un dirigeant populaire « entré en résistance » contre la fraude et les puissants... Une Convention nationale démocratique (CND) de deux millions de personnes qui, le 16 septembre, défient les institutions et le nomment « président légitime »... L’Etat d’Oaxaca insurgé contre son gouverneur... Un président de droite, M. Felipe Calderón, prêtant serment à la sauvette, le 1er décembre, protégé par ses gardes du corps de la colère des parlementaires de gauche...
Tout indiquait, fin 2006, qu’un grand mouvement populaire était en train de naître au Mexique. Candidat de centre gauche « battu » lors de l’élection présidentielle [1], M. Andrés Manuel López Obrador - « AMLO » - semblait avoir rompu avec le programme modéré de sa campagne. Ses envolées sur le Zócalo - la grand-place du centre de Mexico -, fin septembre, évoquaient les discours de MM. Hugo Chávez ou Evo Morales. Toutefois, les fêtes de fin d’année passées, la gauche s’est réveillée avec la « gueule de bois ».
Au-delà de la question de la fraude, elle sait en effet qu’elle aurait pu conquérir la présidence, si elle n’avait pas commis autant d’erreurs : absence d’observateurs dans plus de 30 % des bureaux de vote ; dérapages verbaux du candidat ; manque de clarté du programme déroutant les secteurs populaires qui « ne croient plus en la politique ». Elle s’est en outre usée pendant des semaines dans un long combat pour la « défense du vote » - c’est-à-dire la reconnaissance de sa victoire - au lieu de se présenter à l’opinion publique comme une force alternative qui venait d’obtenir autant de voix que la droite et pouvait imposer le changement. Qualifié de caudillo irresponsable par les médias, « AMLO » a perdu de son prestige dans la classe moyenne.
Répression plutôt que négociation
Pendant ce temps, le président Vicente Fox, avec l’accord de M. Calderón, candidat du Parti d’Action Nationale (PAN) à la présidence, puis M. Calderón lui-même, une fois devenu chef de l’Etat, n’hésitaient pas à réprimer durement le mouvement social d’Oaxaca [2]. A partir du 25 novembre, la reprise en main par la Police Fédérale Préventive (PFP) de la capitale de l’Etat, occupée depuis six mois par les opposants au gouverneur Ulises Ruiz (Parti révolutionnaire institutionnel, PRI), a laissé un lourd bilan : vingt-trois morts recensés et identifiés, tués lors d’affrontements avec la police ou assassinés par des paramilitaires à la solde du gouverneur ; près de quatre cents blessés ; des dizaines de disparus ; plus de trois cents arrestations [3]...
Début décembre, plusieurs responsables de l’Assemblée populaire des peuples d’Oaxaca (APPO), en particulier les journalistes et éditorialistes de Radio Universidad, la voix du mouvement, ont dû fuir et se cacher pour échapper aux hommes de main de M. Ruiz. Trois jours après son installation à la présidence, et préférant la répression à la négociation, M. Calderón a fait arrêter les principaux dirigeants « visibles » de l’APPO, dont M. Flavio Sosa, son porte-parole, alors qu’ils négociaient avec le ministère de l’Intérieur la libération des premiers prisonniers et le retour au calme. Il a ainsi démontré que l’alliance entre le PAN et les secteurs conservateurs du PRI, auxquels appartient le gouverneur Ruiz, serait l’une des pierres angulaires de son gouvernement.
Au terme d’une longue enquête, la Commission Civile Internationale d’Observation des Droits de l’Homme (CCIODH) a conclu, dans un rapport présenté le 20 janvier à Mexico, que ces différentes mesures font partie d’« une stratégie juridique, policière et militaire (...) dont l’objectif ultime est d’obtenir par la peur le contrôle de la population civile [indigène en particulier] dans des zones où se développent des processus d’organisation citoyenne ou des mouvements à caractère social non partisan ».
Las... Fin décembre 2006, les parlementaires du Parti de la Révolution Démocratique (PRD) de M. López Obrador, ont voté le budget 2007 proposé par le président Calderón en échange de maigres concessions en matière d’éducation et de culture. Une trahison, pour beaucoup. Le gouvernement et le PRI se sont félicités de la « maturité » démontrée à cette occasion par l’opposition.
Nombre de militants du PRD doutent de l’engagement de certains de leurs dirigeants, qui n’ont accepté que du bout des lèvres la radicalisation du mouvement imposée par l’ex-candidat à la présidence. Depuis sa fondation en 1989, à l’initiative de dissidents du PRI alors au pouvoir et d’une myriade de partis de gauche à peine sortis de la clandestinité, le PRD - et ses multiples courants, baptisés « tribus » - dépense plus d’énergie à propulser ses membres à des postes de parlementaire ou d’élu local qu’à définir un programme cohérent de changement.
Les deux partis - Parti du travail et Convergence démocratique - qui, pendant la campagne présidentielle, l’ont rejoint au sein de la coalition pour le bien de tous souffrent des mêmes maux. La politique semble se résumer pour beaucoup de politiciens à la négociation de parts de pouvoir. Ex-député fédéral du PRD, M. Francisco Saucedo pense qu’à court terme rien ne changera sous le soleil de la gauche mexicaine. Les responsables de son parti, regrette-t-il, n’ont pas « la fibre populaire à fleur de peau ». Toujours d’après lui, les batailles entre « tribus » immobilisent le PRD.
Pourtant, au-delà des peurs et des frustrations, une tendance de fond se fait jour, qui peut réserver des surprises. La gauche, dans son ensemble, a pris conscience qu’elle affronte désormais une droite conservatrice organisée, déterminée à défendre le modèle néolibéral.
Un tournant a été pris en 2006. Le PRI, le grand parti national et progressiste converti au capitalisme sauvage par M. Carlos Salinas (1988-1994), est le principal perdant des élections. Sur les questions de fond, il s’alliera au PAN et ne réclamera plus que les politiques économiques soient accompagnées de mesures sociales. Beaucoup de dirigeants de gauche jusque-là très modérés en ont conclu qu’il serait vain de chercher à négocier avec lui des aménagements boiteux pour améliorer le sort des cinquante millions de pauvres que compte le pays. La situation est d’autant plus critique que le nouveau gouvernement ne cache pas son intention de renforcer le modèle en place.
L’unité de la gauche devient donc une question de survie. La constitution du Front élargi progressiste - Frente Amplio Progresista (FAP) -, au lendemain de la défaite électorale, répond à cette nouvelle donne. Il rassemble les trois partis membres de la coalition électorale d’« AMLO ». Intitulée « Pour la transformation de Mexico », sa charte proclame : « Pour impulser un changement véritable (...), nous devons faire preuve de fermeté dans l’opposition, de capacité politique à reprendre l’initiative et de détermination. »
Son coordinateur, M. Jésus Ortega, est pourtant l’un des dirigeants du PRD les plus critiqués par la gauche de la gauche. Se définissant comme « social-démocrate », il dirige la « tribu » la plus puissante du PRD, celle qui a toujours privilégié la négociation avec le pouvoir. Cependant, l’évolution de son discours est notable. « Nous devons constituer un grand bloc progressiste, affirme-t-il, pour affronter une droite consolidée comme peu de fois dans notre histoire. (...) Le FAP est un nouveau pas en direction de l’unité de la gauche, dont la constitution du PRD n’a été qu’une étape. (...) Nous devons en outre avancer en termes de propositions, car une autre réalité s’impose : la polarisation de la société et la radicalisation de notre base sociale... »
De son côté, M. López Obrador n’a pas baissé les bras. Elu « président légitime » par la CND réunie en septembre 2006, il a constitué fin décembre son « gouvernement légitime ». Tandis qu’il parcourt le pays, à l’écoute « des gens », son cabinet travaille d’arrache-pied sur de nouvelles propositions de lois. Lors de ses premières tournées, il a rassemblé des auditoires presque aussi nombreux que pendant la campagne électorale ; il met à profit ces meetings pour « encarter » les sympathisants qui y participent.
Vers une offensive concertée
Autre signe du rebond de l’opposition, l’APPO a repris l’initiative. En janvier et février, des dizaines de milliers de marcheurs ont défilé dans Oaxaca pour réclamer la libération de la trentaine de militants encore emprisonnés et exiger à nouveau le départ du gouverneur Ruiz. « Le peuple d’Oaxaca a vaincu son pire ennemi, la peur, après la répression de novembre », assure l’actuel porte-parole de l’organisation, M. Florentino López. Semblant effectivement repartir d’un bon pied, le mouvement envisage d’organiser à nouveau des sit-in sur la place centrale de la capitale de l’Etat. Au point que le gouverneur a demandé en janvier au gouvernement fédéral de faire revenir ses bataillons de police militarisée à Oaxaca.
Encore plus significative, la réunion à Mexico, début février, du Dialogue national, vaste forum rassemblant six cents organisations - très critiques de la « gauche institutionnelle » -, dont le syndicat des électriciens, l’un des plus actifs de Mexico, et de nombreux intellectuels sympathisants du zapatisme. Plusieurs personnalités du FAP y assistaient. Les participants y ont proposé de « créer une union nationale pour freiner le néolibéralisme et ses politiques contraires aux intérêts des travailleurs ». La CND, quant à elle, s’est attachée à préparer une grande concentration pour la fin mars afin de dynamiser le mouvement lancé en septembre 2006 par « AMLO ».
Ces frémissements annoncent-ils une « bolivianisation » du mouvement mexicain ? Celui-ci pourra-t-il imposer le changement sans disposer d’une majorité parlementaire, comme l’a fait M. Morales, avant même sa victoire électorale, en s’appuyant au parlement sur un « instrument politique » discipliné - le Mouvement vers le socialisme (MAS) - et sur la mobilisation populaire ? L’exemple le plus achevé de cette stratégie fut le vote par le Congrès bolivien, le 17 mai 2005, d’une loi sur les hydrocarbures, imposée au gouvernement néolibéral de l’époque, qui a constitué un premier pas vers la nationalisation des ressources énergétiques.
Il est douteux que la gauche mexicaine puisse donner le jour, dans le court terme, à un instrument politique unique. Mais ses différents appareils mèneront sans doute une offensive concertée. La campagne d’adhésions entamée début janvier par le « gouvernement légitime » va tambour battant. Le rythme actuel dépasse les prévisions. L’objectif final est de constituer une nouvelle base sociale prête à « répondre à l’appel ou à la convocation du président légitime pour défendre sa cause », comme le stipule la lettre d’engagement signée par les sympathisants de M. López Obrador. Elle pourrait déborder largement la base militante du PRD, qui ne compte que quatre millions d’affiliés, car quatorze millions de Mexicains ont voté pour lui.
Bien que M. López Obrador nie toute intention de créer un nouveau parti unique de la gauche, la démarche en dit long sur le bras de fer qu’il a engagé avec les politiciens du PRD ou du centre gauche dont il se méfie. Sa « ministre » du travail, Mme Berta Lujan, le reconnaît implicitement : « Le gouvernement légitime, le FAP et la CND travailleront ensemble, mais notre représentation au Congrès sera désormais contrôlée par une base sociale attentive, qui constituera un mur de contention contre les déviations et les trahisons », estime-t-elle, se référant par exemple au vote par le PRD, en 2005, d’une loi offrant, de fait, un monopole de la communication aux deux grandes télévisions privées du pays. S’il est suivi d’effets, le propos de Mme Lujan, militante syndicale altermondialiste aguerrie, confirmera un profond changement de cap, car M. López Obrador lui-même ne s’était pas opposé à l’adoption de cette loi.
M. Ortega et les principaux dirigeants du PRD tentent, eux, d’intégrer de nouvelles forces au FAP. « Nous venons de signer un accord historique avec l’Union nationale des travailleurs [indépendante des syndicats clientélistes contrôlés par le PRI et le PAN], fait remarquer M. Ortega. Sur des bases claires : pour la défense des ressources énergétiques, du salaire minimum et de l’emploi, et pour la renégociation du chapitre agricole du traité de libre commerce signé en 1993 avec les Etats-Unis. »
Le FAP pourrait ainsi s’ouvrir à un petit parti de gauche - Alternative sociale-démocrate et paysanne - qui a ravi plus d’un million de voix à M. López Obrador, à certains secteurs de la Confédération paysanne (pourtant d’origine priiste) et à l’APPO. « Cette organisation a un contenu démocratique exemplaire », remarque M. Ortega, qui ne semble pas gêné que l’extrême gauche y joue un rôle important.
Cette ouverture confirmerait que la gauche politique veut s’appuyer sur l’ensemble des acteurs de l’opposition. Modèle d’organisation née de la base pour la défense de valeurs et d’intérêts locaux, sans arrière-pensées politiciennes, l’APPO s’est en effet constituée en dehors du PRD, voire contre lui. On y trouve des zapatistes parmi les étudiants de l’université d’Oaxaca et, dans certaines communautés indigènes de l’Etat, les organisations indiennes déjà existantes [4] ; des militants régionaux du PRD ; des syndicalistes enseignants ; des membres des réseaux urbains de différents groupes guérilleros marxistes-léninistes ; et des associations civiles urbaines issues de la classe moyenne, qui luttent pour l’écologie, la défense du patrimoine culturel, les droits de l’homme, l’éducation laïque et gratuite, les droits de la femme, la défense des émigrants...
En tout état de cause, M. López Obrador, ses « ministres » et le FAP se réunissent chaque lundi pour définir, non sans mal, des objectifs communs. Ils promettent de présenter à l’opinion et au Parlement, avant la fin de l’année, quatre réformes importantes :
— une réforme fiscale établissant une réelle progressivité de l’impôt sur le revenu et une taxe effective sur les plus-values et la fortune ;
— une loi anticorruption assortie d’une réduction drastique des salaires des ministres et hauts fonctionnaires ;
— une réforme de l’Etat privant le président de ses pouvoirs discrétionnaires ;
— une réforme du code du travail limitant la précarité de l’emploi et assurant l’indépendance du mouvement syndical coopté par l’Etat.
La CND travaille sur un plan global de révisions législatives. Des initiatives « réformistes » qui apparaissent comme « révolutionnaires » dans un pays où les privilèges et les abus dépassent l’entendement. Les actionnaires de Banamex ont, par exemple, vendu leur banque à l’américaine City Bank pour 12 milliards de dollars sans payer un centime d’impôt, grâce à la mise en œuvre d’un « régime spécial » protégeant la transaction. Pendant ce temps, des millions d’employés de l’Etat et du privé, les travailleurs dits « de confiance », ne disposent d’aucun contrat de travail et peuvent être licenciés à tout moment - certes avec indemnisation, mais sans possibilité de recours réel pour conserver leur emploi.
Le « gouvernement légitime » mobilisera-t-il la rue pour appuyer ses propositions ? Mme Lujan assure qu’il le fera, systématiquement, pour défendre les droits acquis ou les conquêtes sociales comme le salaire minimum ou le contrôle par l’Etat des hydrocarbures et de l’énergie électrique. Et, au coup par coup, pour imposer des réformes structurelles.
Pour savoir si le conflit électoral de 2006 a donné naissance à une nouvelle gauche, il faudra néanmoins attendre une échéance symbolique. En 2008 entrera en vigueur le chapitre agricole de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena), signé fin 1992 entre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada. Il prévoit que les produits agricoles américains pourront entrer au Mexique sans payer de droits de douane. Une mesure qui affecterait durement trois millions de familles d’agriculteurs incapables de faire face à la concurrence. M. López Obrador jure qu’il exigera la renégociation du traité sur ce point.
Embryon de changement national
Si la gauche mexicaine manifeste alors massivement pour la défense de ses paysans, elle rejoindra - sans le vouloir peut-être - la gauche sud-américaine, qui a fait du refus des accords de libre-échange son cheval de bataille depuis quinze ans. Pourra-t-elle aller plus loin ? Mme Lujan n’exclut pas que le « gouvernement légitime » propose, à terme, l’intégration du Mexique dans l’Alternative Bolivarienne pour les Amériques (Alba) [5] tout en restant lié aux Etats-Unis dans le cadre de l’Alena.
Mais l’échéance est encore lointaine, et de nombreux obstacles freinent pour l’instant cette dynamique de construction d’un « instrument politique » représentant toutes les forces progressistes du pays. Les dirigeants de la gauche radicale - les zapatistes en particulier - et de nombreux dirigeants de la gauche sociale rassemblés dans le Dialogue National affirment que le FAP ne pourra pas assumer ce rôle, même s’il s’ouvre à des organisations comme l’APPO. Les dirigeants du FAP, disent-ils, continueront à privilégier, dans une logique purement électorale, la négociation avec le pouvoir. Ils pensent que l’intérêt du gouvernement de M. Calderón et du PRI est de céder, dans l’espoir de se consolider, sur un petit nombre de revendications sociales et démocratiques, comme la défense du pouvoir d’achat ou la réforme de l’Etat.
S’apprêtant à lancer la seconde phase de l’« autre campagne [6] » pour doter le zapatisme d’une base nationale, le sous-commandant Marcos persiste, au nom de l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN), dans ses attaques contre le FAP et M. López Obrador. Il est vrai que ces derniers, en janvier, lui ont encore offert l’occasion de dénoncer leur manque de cohérence. Pour augmenter leurs chances de gagner les prochaines élections locales dans l’Etat du Yucatán, ils envisageaient de nommer une dissidente ultraconservatrice du PAN comme candidate unique du FAP. « Et maintenant, ironisa Marcos dans l’un de ses fameux communiqués au vitriol, ils nous disent qu’“AMLO” et l’“autre campagne” doivent coïncider (ah ! ah !) alors qu’ils recrutent les rescapés du naufrage de l’extrême droite !!! » Se rendant compte de l’incongruité de la situation, le PRD et le FAP ont renoncé à la candidature de la transfuge. Sous la pression, dit-on, de M. López Obrador... qui jusque-là ne s’y était pas opposé.
En même temps, M. López Obrador et son « gouvernement légitime » se démarquent, d’une certaine manière, de la « gauche institutionnelle ». Convaincus que le gouvernement de M. Calderón ne cédera pas sans mobilisations populaires, ils parient sur la CND, espérant qu’elle propulsera sur le devant de la scène une nouvelle classe de dirigeants capable d’imposer une ligne plus « rupturiste » au FAP, à M. Ortega et aux anciens membres du PRI qui ont rejoint le PRD dans les années 1990. Sous-directeur du journal de gauche La Jornada, Josetxo Zaldua voit là une contradiction, car M. López Obrador, ancien priiste lui-même, n’aurait pas la « flexibilité nécessaire pour rassembler les éléments épars de la gauche et se démarquer d’une approche populiste ».
En fait, beaucoup dépendra de l’APPO, qui apparaît aujourd’hui comme « un embryon de changement national », pour reprendre les termes de M. Tómas Martínez, membre de sa nouvelle direction. Après huit mois d’affrontements et de répression, l’organisation a, semble-t-il, choisi la voie de la résistance pacifique, se démarquant de ses éléments les plus radicaux. Elle poursuivra sa mobilisation pour exiger le départ de M. Ruiz et la convocation d’une constituante « refondant » l’Etat d’Oaxaca, mais ne dédaignera pas la voie électorale pour faire avancer sa cause.
Début janvier, elle envisageait de présenter des candidats sous la bannière du FAP aux prochaines élections de l’Etat d’Oaxaca. Elle est revenue sur cette intention fin janvier, mais continue de négocier avec le PRD. Impensable il y a trois mois, une alliance avec le « gouvernement légitime », dans le cadre de la CND, semble possible.
Face au projet unitaire, deux certitudes s’imposent : l’« autre campagne » du sous-commandant Marcos n’en sera pas, officiellement, partie prenante - même si de nombreux sympathisants zapatistes se sentent concernés -, et les responsables les plus modérés du FAP entendent bien ne pas se laisser déborder. « La seule solution, c’est que la gauche sociale, syndicale, culturelle, non partisane, et l’APPO se fondent avec nous dans une grande convention nationale démocratique qui se transforme en une puissante force de mobilisation populaire », confie M. Jésus Ramírez, jeune conseiller de M. López Obrador. Venu du zapatisme et conscient des difficultés qu’affronte le mouvement, il n’en est pas moins convaincu que la bataille, qui ne fait que commencer, peut être gagnée.
Car ce sont bien trois gauches qui se sont réveillées à la chaleur du conflit postélectoral. L’une qui refuse l’affrontement. La deuxième qui partage avec la première l’idée de changer le pays par la voie de réformes législatives, mais sait que rien n’est envisageable sans une mobilisation massive des mécontents. La troisième qui parie sur la stratégie du débordement. « Oaxaca, c’est déjà notre Bolivie », affirme Luis Hernandez Navarro, éditorialiste et fin connaisseur des subtilités de la gauche mexicaine.









 José Guzmán Montalvo, ex administrador General de Aduanas, fue el principal enlace de las operaciones criminales de Zhenli Ye Gon.
José Guzmán Montalvo, ex administrador General de Aduanas, fue el principal enlace de las operaciones criminales de Zhenli Ye Gon.